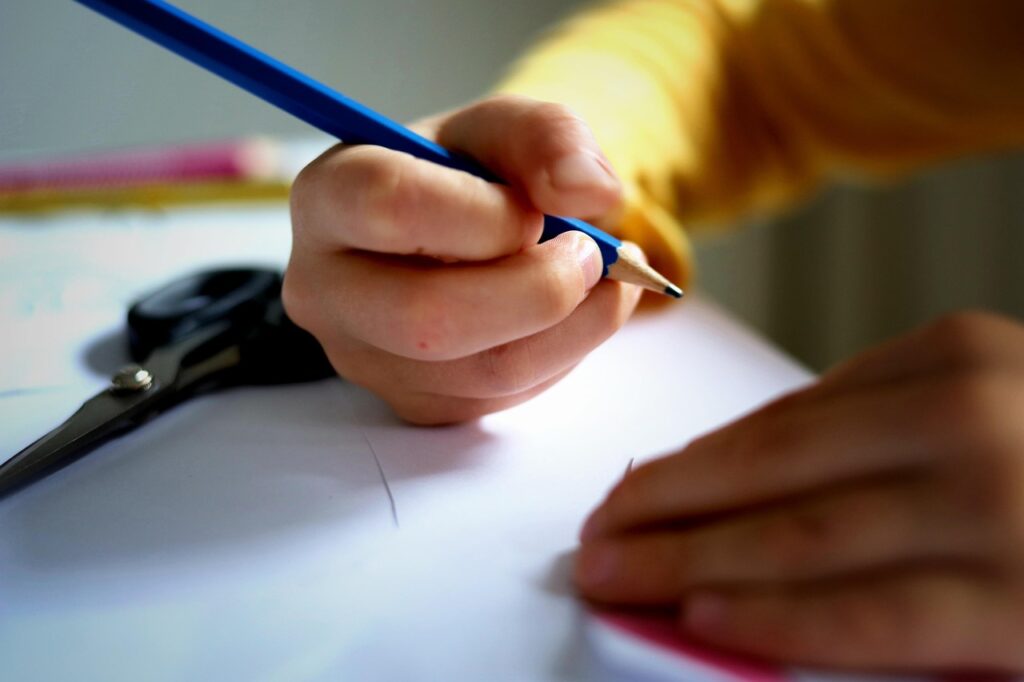Il y a cinq ans, au cours de l’été 2020, les enseignants du monde entier s’apprêtaient à vivre une rentrée inédite. Le mois de septembre correspondait au retour à l’école de leurs élèves après une année scolaire perturbée par l’arrivée de la pandémie mondiale de Covid-19, et les confinements qui en ont découlé. En France, cette reprise signait le début d’une période jalonnée par de nouvelles restrictions sanitaires, mais aussi par la gestion du retard scolaire accumulé. Un aspect qui a demandé toute une organisation aux établissements, notamment pour ceux établis dans des Réseaux d’Education Prioritaires ou des Réseaux d’Education Prioritaires Renforcés (REP +). Mireille (le prénom a été modifié), qui enseigne depuis 27 ans dans une REP + et se charge du niveau CP depuis 10 ans, a accepté de revenir sur cette période particulière de sa carrière.
Des besoins quotidiens importants
L’école dans laquelle exerce Mireille est basée en Normandie, dans un Réseau d’Éducation Prioritaire Renforcée (REP +). Une situation qui permet de débloquer des moyens supplémentaires adaptés aux besoins spécifiques de ses élèves. Dans les zones prioritaires, les niveaux de Grande Section, CP et CE1 sont dédoublés. “En CP on a eu 12 élèves par classe, ce qui donnait la possibilité d’offrir un enseignement plus individualisé, favorable à la réduction des écarts de niveau et donc des inégalités”, commence Mireille avant de reprendre : “Avec ce nombre, on pouvait aussi faire lire tout le monde tous les jours. C’était aussi plus facile de faire des manipulations en mathématiques.” Depuis trois ans, les CP ne sont plus dédoublés mais allégés, le nombre d’élèves est donc remonté à quinze.
En temps normal, ces enseignements sont adaptés aux réalités des élèves que Mireille rencontre sur le terrain mais le confinement total lié au Covid-19 est venu rebattre les cartes en ajoutant un autre défi : celui du retard accumulé sur l’année 2019 – 2020.
Le suivi pendant le confinement
L’importance du retard des élèves dépend en grande partie de la manière dont ils ont pu suivre le travail donné à distance entre le 17 mars et le 11 mai 2020, période du premier confinement. “J’appelais les enfants tous les deux jours pour les faire lire au téléphone, et j’envoyais des mails quotidiennement pour donner le travail à faire”, détaille Mireille. Cette implication n’a pu empêcher la rupture scolaire de certains élèves, voire la perte de contact avec des familles. “Les enfants les plus marqués sont les plus défavorisés et ceux dont les parents ne pouvaient pas prendre le relais à la maison”, se remémore Mireille. Manque de compétences pour expliquer les cours, des priorités placées ailleurs… Plusieurs éléments expliquent cette rupture scolaire.
A cela s’ajoute la fracture numérique. “Beaucoup de nos familles ont accès à internet sur le téléphone, mais ne disposent ni d’ordinateur, ni d’imprimante”, poursuit l’enseignante.
Un retour timide
Le 11 mai, l’heure du retour à l’école a sonné. Pourtant, les bancs où travaille Mireille ont demeuré semi-remplis jusqu’à la rentrée scolaire de septembre. “Certains parents n’ont pas remis les enfants à l’école. Il y avait beaucoup de craintes. D’autres ont un peu profité de la situation.”
L’école s’est attelée à recenser les familles qui comptaient remettre ou non leurs enfants. La réintégration de ces derniers s’est faite progressivement. “On a maintenu le distanciel pendant encore quelques semaines pour permettre un retour dans les meilleures conditions », reprend Mireille. La prise en charge du retard commence à ce moment et s’étendra parfois sur plusieurs années.
Un soutien rapproché
La suite s’écrit en septembre 2020 à la rentrée des classes. Si certains parents sont encore réticents à l’idée de laisser leurs enfants, tous finissent par reprendre le chemin de l’école. Les enseignants utilisent l’Activité Pédagogique Complémentaire (APC), un soutien scolaire d’1h30 par semaine spécifique aux REP et REP +, pour tenter de réhomogénéiser au maximum les niveaux. Ils ciblent en priorité les élèves très marqués par le confinement
En plus de cet important défi, Mireille et ses collègues doivent composer avec une capacité d’attention qui a diminué chez les élèves. « Pendant le confinement, les enfants ont passé beaucoup de temps sur les écrans, ce qui a fortement réduit leur capacité d’attention. Pour les niveaux de CP, cette consommation excessive a aussi occasionné des retards de langage. »
Les groupes de soutien renforcé ont constitué une période charnière qui a fini par porter ses fruits. « Au début, on a réussi à diminuer les écarts entre les élèves sans les réduire complètement. Maintenant, j’ai l’impression que ça s’est bien régulé. C’est un travail qui s’est fait sur plusieurs années. »
Le lien d’attachement entre les enfants et leurs familles a lui été davantage bousculé. « Certains ont plus de mal à laisser leurs parents. On l’observe chez les enfants de CM1 qui ont été marqués par ce moment-là. »
Et le rapport à la nature ?
Sur une telle période, le rapport des jeunes et la nature aurait lui aussi pu être bouleversé, ce qui n’a pas été le cas. Ce dernier répond, en réalité, à une problématique plus globale. « Au départ, les enfants ne sortent que très peu du quartier. Le confinement n’a ni aggravé, ni amélioré la situation », explique Mireille. Une culture très encrée et installée bien avant le confinement.
Ce constat peut être compensé par le programme de l’école qui prévoit la découverte de la nature mais organiser des sorties n’est pas toujours simple. « On a des limites de budget et du mal à mobiliser les parents », regrette l’enseignante.
Quand les sorties en nature voient le jour, elles s’inscrivent dans le cadre de l’éducation à la citoyenneté et à l’environnement. « L’année dernière, la sortie à la ferme pédagogique, c’était quelque chose de magique. Les enfants sont émerveillés par tout ce qu’ils voient », se remémore Mireille. Ces sorties constituent tout autant d’occasions de créer une relation avec la nature. Un lien dont l’importance a notamment été mise en exergue au cours du confinement.