Une conférence entre ciel et guerre
Suspendu au-dessus du lac de Lucerne, le luxueux complexe du Bürgenstock semble avoir été dessiné pour la solennité. Lieu d’isolement, de silence et de luxe, il a été choisi pour abriter ce que Volodymyr Zelensky n’a cessé d’appeler “un tournant historique vers la paix”. Près de 100 délégations étaient présentes ce week-end de juin, parmi lesquelles Ursula von der Leyen, Emmanuel Macron, Justin Trudeau, mais aussi des représentants du Qatar, du Kenya ou encore du Vatican.
Pour la Suisse, patrie des Conventions de Genève, l’enjeu était double : réaffirmer son rôle traditionnel de médiateur neutre, et offrir à l’Ukraine une tribune internationale. Pour l’Ukraine, cette conférence représentait une bouffée d’air stratégique et diplomatique. Tandis que les tranchées de Donetsk continuent de saigner et que les renforts occidentaux tardent à arriver, Bürgenstock était l’occasion de replacer la guerre dans le récit du droit international, et de s’opposer à l’indifférence croissante d’un monde qui regarde ailleurs.
Mais l’image est trompeuse. Car malgré les tapis rouges et les photos de groupe, l’événement n’a pas été une négociation. C’était, selon les mots d’un diplomate européen, “une mise en scène diplomatique, pas un processus de paix”. Le grand absent, la Russie, n’avait ni siège ni voix. Et la Chine, acteur pivot potentiel d’une médiation, avait refusé de venir. La “conférence de la paix” s’est donc tenue sans guerre à négocier ni ennemis à convaincre.
L’Ukraine cherche des alliés, pas des compromis
Depuis le début de l’invasion à grande échelle en février 2022, Kiev se bat sur deux fronts : le front militaire, où elle résiste avec un courage salué mais des moyens déclinants ; et le front diplomatique, où elle s’efforce d’empêcher que la guerre ne se banalise ou ne devienne une affaire strictement européenne.
À Bürgenstock, le président Zelensky a rappelé les fondements de sa “formule de paix” en dix points, déjà présentée au G20 fin 2022 : sécurité nucléaire, sécurité alimentaire, libération des prisonniers et des enfants déportés, retrait des troupes russes, et rétablissement de l’intégrité territoriale de l’Ukraine. Lors de son allocution d’ouverture, il a martelé avec gravité : “Le monde ne peut pas rester neutre face à l’agression. La paix ne doit pas être négociée sous la menace des armes, mais bâtie sur les principes de la Charte des Nations unies.”
Mais cette vision n’a pas trouvé un écho universel. Si les pays occidentaux ont signé sans réserve le communiqué final, qui reprend trois des dix points ukrainiens comme priorités immédiates, de nombreux pays du “Sud global” ont refusé de l’endosser, préférant rester dans une posture d’observation prudente. Pour certains, il s’agit de préserver des canaux de dialogue avec Moscou ; pour d’autres, de ne pas être perçus comme des instruments de la diplomatie occidentale.
Le Sud global, arbitre silencieux d’un monde désaligné
La présence de pays comme l’Arabie saoudite, le Brésil, l’Inde ou encore l’Afrique du Sud a été saluée comme un signe d’ouverture. Mais leur refus de signer le texte final révèle une fracture plus profonde : une méfiance croissante à l’égard du récit occidental de la guerre. Derrière les sourires et les poignées de main, c’est une diplomatie de l’ambiguïté qui s’est exprimée.
De nombreux États du Sud perçoivent la guerre en Ukraine comme un conflit régional aux enjeux géostratégiques entre grandes puissances, et non comme une guerre mondiale du droit contre la force. D’autres pointent une hypocrisie persistante : pourquoi tant d’attention diplomatique pour Kyiv, et si peu pour Gaza, le Soudan ou le Sahel ? Pourquoi le droit international serait-il à géométrie variable ?
“Nous ne pouvons pas soutenir un processus de paix auquel une des parties prenantes majeures n’a pas été invitée”, a déclaré le ministre des Affaires étrangères sud-africain. Une remarque sobre, mais lourde de sens.
Cette posture traduit aussi un rééquilibrage global : les anciennes puissances coloniales ne dictent plus le récit. Pékin, qui se présente volontiers comme une puissance de paix, refuse de s’associer à une initiative qu’elle juge déséquilibrée et conçue pour “isoler Moscou diplomatiquement”. En privé, plusieurs diplomates européens reconnaissent que sans la Chine, aucun cadre global de négociation ne peut réellement émerger.
La Russie absente… mais omniprésente
Officiellement, Moscou a tourné le dos à Bürgenstock. Le Kremlin a qualifié la conférence de “mascarade” et affirmé qu’il n’y avait rien à attendre d’un sommet organisé par des “ennemis de la Russie”. Et pourtant, deux jours avant l’ouverture du sommet, Vladimir Poutine a pris tout le monde de court en proposant ce qu’il a présenté comme un “plan de paix”.
Les conditions posées par le président russe sont inacceptables pour Kiev : retrait des forces ukrainiennes du Donbass et du sud de l’Ukraine, reconnaissance de l’annexion de la Crimée, et abandon de toute ambition d’adhésion à l’OTAN. En somme, une reddition. Mais cette sortie médiatique n’est pas anodine. Elle montre que la Russie suit avec attention le calendrier diplomatique et cherche à reprendre la main, même de façon cynique.
Pour plusieurs analystes, ce “plan Poutine” vise à semer le doute dans les opinions publiques occidentales. À faire croire que la paix est possible, si seulement l’Ukraine cessait de résister. C’est aussi un message aux pays non-alignés : la Russie peut parler de paix, mais à ses conditions. La guerre continue, mais la bataille de la légitimité est loin d’être finie.
Le chercheur russe Andreï Kolesnikov, du Carnegie Russia Eurasia Center, résume cette posture : “Poutine n’a pas besoin d’un traité. Il a besoin d’un récit de victoire, même illusoire, pour consolider son pouvoir et diviser les adversaires de la Russie.”
Une guerre de récits avant la guerre des tranchées
Sur le terrain, la situation militaire reste figée et inquiétante. L’armée ukrainienne, bien que soutenue par des livraisons d’armement récemment relancées par Washington et Berlin, peine à contenir la poussée russe dans l’Est. La ligne de front est stable mais sanglante. Le moral des troupes est usé, et la démographie militaire ukrainienne est une source de tension croissante dans le pays.
Cette guerre d’usure met à rude épreuve la résilience ukrainienne. La réforme de la conscription, adoptée dans la douleur, révèle les limites humaines d’un conflit qui s’éternise. Côté russe, les pertes sont massives mais compensées par un réservoir humain encore intact et une industrie militaire remise à flot grâce aux efforts d’économie de guerre et au soutien d’acteurs comme la Corée du Nord ou l’Iran.
Dans ce contexte, la conférence de Bürgenstock ressemble presque à une parenthèse diplomatique, une tentative de créer de l’espace, non pas pour négocier avec l’ennemi, mais pour réorganiser les soutiens. Comme le résume l’expert américain Michael Kimmage dans Foreign Affairs : “Bürgenstock n’est pas une étape vers la paix, mais une bataille pour l’avenir diplomatique de la guerre. Qui fixe l’agenda, qui formule les principes, qui est inclus, qui est marginalisé ? Voilà ce qui est en jeu.”
Le danger, selon certains diplomates, serait d’installer un processus diplomatique parallèle, qui ne mènerait nulle part mais qui servirait de prétexte à l’inaction, pendant que les canons continuent de parler. Car la guerre ne se réglera pas avec des communiqués. Elle prendra fin soit par une défaite, soit par un compromis douloureux. Or, à Bürgenstock, personne n’a encore montré la volonté de faire ce pas.
L’élégance du décor, l’amertume du réel
En quittant Bürgenstock, les délégations se sont félicitées d’une “première étape importante”. Une autre conférence est envisagée, possiblement à Riyad, cette fois avec la Russie. Peut-être. Mais l’élan semble déjà fragile.
La Suisse, fidèle à son rôle, a offert un cadre. L’Ukraine a fixé des principes. L’Occident a réaffirmé son soutien. Le Sud a temporisé. La Russie a grondé depuis l’ombre. La Chine s’est tue.
Il reste ce panorama sublime, ces salles vitrées sur les cimes, ces discours ciselés dans un décor de carte postale. Et, dans le silence, cette question obsédante : une paix sans ennemis, est-ce encore de la paix, ou simplement de l’incantation ?






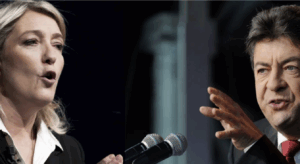




14 comments
Your blog is a testament to your passion for your subject matter. Your enthusiasm is infectious, and it’s clear that you put your heart and soul into every post. Keep up the fantastic work!
Your blog is a beacon of light in the often murky waters of online content. Your thoughtful analysis and insightful commentary never fail to leave a lasting impression. Keep up the amazing work!
I loved as much as youll receive carried out right here The sketch is attractive your authored material stylish nonetheless you command get bought an nervousness over that you wish be delivering the following unwell unquestionably come more formerly again as exactly the same nearly a lot often inside case you shield this hike
you are truly a just right webmaster The site loading speed is incredible It kind of feels that youre doing any distinctive trick In addition The contents are masterwork you have done a great activity in this matter
Hi Neat post There is a problem along with your website in internet explorer would test this IE still is the market chief and a good section of other folks will pass over your magnificent writing due to this problem
My brother recommended I might like this web site He was totally right This post actually made my day You cannt imagine just how much time I had spent for this information Thanks
you are in reality a good webmaster The website loading velocity is amazing It sort of feels that youre doing any distinctive trick Also The contents are masterwork you have done a fantastic job in this topic
Your blog is a treasure trove of valuable insights and thought-provoking commentary. Your dedication to your craft is evident in every word you write. Keep up the fantastic work!
Hey there You have done a fantastic job I will certainly digg it and personally recommend to my friends Im confident theyll be benefited from this site
I just could not leave your web site before suggesting that I really enjoyed the standard information a person supply to your visitors Is gonna be again steadily in order to check up on new posts
I was suggested this web site by my cousin Im not sure whether this post is written by him as no one else know such detailed about my trouble You are incredible Thanks
helloI really like your writing so a lot share we keep up a correspondence extra approximately your post on AOL I need an expert in this house to unravel my problem May be that is you Taking a look ahead to see you
Game achievement platforms
I’ve been following your blog for some time now, and I’m consistently blown away by the quality of your content. Your ability to tackle complex topics with ease is truly admirable.