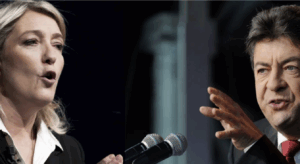Un crépuscule historique
Le 12 mai 2025, dans les replis abrupts et brumeux des monts Qandil, théâtre depuis quatre décennies d’un conflit aussi têtu que tragique, le PKK, Parti des Travailleurs du Kurdistan, a annoncé sa dissolution. Ce geste, annoncé dans une déclaration lue par des députés kurdes à Diyarbakır, a mis un point final à l’une des insurrections armées les plus durables et controversées du XXe et XXIe siècle. Fondé en 1978 autour d’un noyau marxiste-léniniste aspirant à un Kurdistan indépendant, le PKK a embrasé les montagnes, ensanglanté les vallées, et structuré une identité kurde longtemps niée.
Depuis 1984, date de son entrée en guerre contre l’État turc, le bilan humain est accablant : plus de 40 000 morts, dont près de la moitié sont des civils selon le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (OHCHR). Des milliers de villages kurdes rasés, des millions de déplacés internes, des générations entières scolarisées entre deux couvre-feux. L’histoire du PKK est celle d’un feu qui brûle à la fois ses ennemis et sa propre base sociale.
Öcalan : l’appel du silence
Ironie de l’histoire, c’est du fond d’une prison que l’ordre de mettre fin aux armes a été lancé. Abdullah Öcalan, chef incontesté du PKK depuis sa fondation, incarcéré sur l’île-prison d’Imrali depuis 1999, a adressé une lettre en février 2025 appelant ses anciens camarades à « cesser toute activité armée » et à « transformer la lutte en mouvement civil et politique ».
Selon des sources proches du Parti pour la Démocratie des Peuples (DEM, ex-HDP), Öcalan aurait été autorisé à recevoir la visite d’un groupe d’intellectuels pro-gouvernementaux dans le cadre d’une médiation officieuse. Ce n’est pas la première fois que le leader kurde propose la paix, un processus similaire avait échoué en 2015, mais cette fois, le ton est sans ambiguïté : « Le temps des montagnes est terminé. L’Histoire nous regarde. » À 76 ans, l’idéologue du confédéralisme démocratique semble avoir reconnu les limites de la lutte armée.
Une organisation minée de l’intérieur et encerclée
Depuis la fin de l’alliance de circonstance avec les États-Unis en Syrie, où les YPG (Unités de protection du peuple, branche syrienne du PKK) avaient été l’un des fers de lance de la lutte contre Daech, la donne stratégique s’est profondément modifiée. La Turquie, par des opérations répétées baptisées Claw-Lightning, Claw-Sword, Claw-Lock, a méthodiquement démantelé les bastions du PKK dans le nord de l’Irak avec la bénédiction tacite de Bagdad et Erbil.
À cela s’ajoute une hémorragie humaine : les désertions se sont multipliées, notamment parmi les jeunes recrues originaires des villes turques, désillusionnées par la vie austère des camps de montagne et attirées par une alternative politique civile incarnée par le DEM.
La pression diplomatique aussi a porté ses fruits : l’Union européenne a maintenu le PKK sur sa liste des organisations terroristes, tandis que les États-Unis, bien que ambigus sur les YPG, ont clairement condamné les activités du PKK sur le sol irakien.
Ankara : victoire tactique ou mirage stratégique ?
Le gouvernement turc, dans un communiqué triomphal, a salué la dissolution comme une « victoire historique du peuple turc contre le terrorisme ». Le ministre de l’intérieur Ali Yerlikaya a promis « zéro tolérance pour les résidus de l’organisation », et annoncé la poursuite des opérations jusqu’à « l’éradication complète de toutes les cellules dormantes ».
Mais derrière la rhétorique de victoire, le dilemme turc reste entier. Que faire d’un mouvement désarmé mais politiquement toujours influent ? Si l’on ajoute à cela les revendications du DEM, levée de l’interdiction du kurde dans l’espace public, réforme de la Constitution, amnistie pour les prisonniers politiques, la dissolution du PKK pourrait bien être un levier plus politique que sécuritaire.
Le président Erdoğan, affaibli par la crise économique (une inflation toujours au-dessus de 40 %, un chômage des jeunes supérieur à 25 %), pourrait être tenté par un virage « réconciliateur » à l’approche des élections de 2026. Ou alors, comme en 2013-2015, instrumentaliser le processus pour resserrer son emprise.
La société kurde entre désillusion et espérance
Dans les rues de Diyarbakır, de Van ou de Hakkâri, l’annonce a été accueillie avec une prudence résignée. « Ce n’est pas la paix, c’est un changement de stratégie », glisse un enseignant dans un café du quartier de Sur. Une militante féministe kurde, interrogée par Al-Monitor, insiste : “Le PKK disparaît, mais les raisons de sa naissance sont toujours là.”
Car la question kurde, au-delà de la violence, reste une blessure ouverte dans le tissu national turc : interdiction du kurde dans les écoles publiques, faible représentation politique, répression régulière des manifestations, arrestations arbitraires de maires kurdes. Dans ces conditions, une paix durable ne peut être réduite à la reddition d’un groupe armé.
Les voix du dehors : prudence diplomatique, attente humanitaire
La communauté internationale a réagi sobrement. L’Union européenne a salué « un pas important vers la stabilité », tout en appelant la Turquie à « respecter les droits culturels et politiques de sa population kurde ». Amnesty International a immédiatement appelé Ankara à libérer les prisonniers politiques kurdes incarcérés pour des délits d’opinion. Quant à l’ONU, elle a proposé sa médiation pour faciliter une transition vers une « reconstruction inclusive ».
Dans le nord de la Syrie, les autorités de l’Administration autonome kurde restent silencieuses, inquiètes d’un effet domino. « Si le PKK disparaît, que deviennent nos alliances militaires et nos revendications ? », s’interroge un responsable du Rojava, sous couvert d’anonymat.
Vers un après incertain
Dissoudre une armée, c’est facile sur le papier. Mais que deviennent les milliers de militants formés au combat, les vétérans blessés, les femmes qui ont quitté leurs familles pour « la cause » ? Le PKK, c’était aussi une utopie socialisante, un espace d’émancipation pour nombre de jeunes Kurdes, et surtout de jeunes femmes. Leur retour à la vie civile risque d’être semé d’ombres, d’ostracisme et de désillusions.
Des ONG kurdes demandent la mise en place d’un programme de désarmement, démobilisation et réintégration (DDR) sous supervision internationale. Le gouvernement turc, pour l’heure, reste muet sur ce sujet.
Épitaphe pour un rêve ?
Le PKK est mort, mais le rêve kurde, lui, ne l’est pas. Ce rêve d’un peuple parlant sa langue, honorant ses morts, décidant de son destin. Si la dissolution du PKK ouvre la voie à une reconnaissance politique, alors ce sera un tournant historique. Si elle n’est qu’un épilogue militaire, ce ne sera qu’un chapitre de plus dans le long livre des répressions et des révoltes.
Comme l’écrivait le grand poète kurde Cigerxwîn :
« Si un feu s’éteint dans la montagne, une étincelle renaît dans la plaine. »