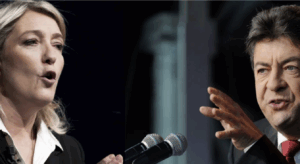Pourquoi l’Iran inquiète ?
L’Iran enrichit aujourd’hui de l’uranium à un niveau de 60 %, un seuil proche de celui nécessaire à la fabrication d’une arme nucléaire. Or, selon l’accord de Vienne signé en 2015 (le JCPOA), le pays s’était engagé à ne pas dépasser 3,67 %, bien en-dessous du seuil militaire (environ 90 %).
Mais cet accord a volé en éclats depuis que les États-Unis s’en sont retirés en 2018, sous Donald Trump. Depuis, l’Iran a relancé son programme nucléaire sans véritable contrôle, affirmant qu’il est uniquement destiné à des fins civiles (énergie, santé, recherche). Ce discours reste difficile à croire pour les puissances occidentales, qui voient dans cette stratégie une tentative de se doter d’un levier géopolitique majeur : la bombe nucléaire. En effet, le président Emmanuel Macron a récemment déclaré que le programme nucléaire iranien est « proche du point de non-retour », soulignant qu’il représente désormais un défi stratégique majeur pour l’Europe.
Un bras de fer diplomatique
À Istanbul, les discussions sont tendues. L’Union européenne, par la voix du trio E3 (Paris, Berlin, Londres), exige que l’Iran revienne aux limites de l’accord de Vienne de 2015 (JCPOA), notamment en réduisant son niveau d’enrichissement et en acceptant à nouveau les inspections approfondies de l’AIEA (Agence internationale de l’énergie atomique).
Faute d’avancée d’ici le 29 août, les Européens menacent de déclencher le mécanisme dit du « snapback », qui rétablirait automatiquement toutes les sanctions de l’ONU levées en 2015. Cependant, le “snapback” serait redoutable parce qu’il mettrait fin à la diplomatie, relancerait l’isolement de l’Iran, pénaliserait les civils et ouvrirait la voie à une nouvelle crise nucléaire. C’est une arme juridique légale, mais à très haut risque politique et humain.
Un Iran intransigeant
Le vice-ministre Kazem Gharibabadi dénonce une posture hypocrite des Européens, qu’il accuse de garder le silence face aux frappes israéliennes contre des installations nucléaires iraniennes. Pour Téhéran, le programme nucléaire est un droit souverain, garanti par les traités internationaux, et toute tentative de réimposer des sanctions serait perçue comme une manœuvre d’asphyxie économique. En réponse au possible retour du snapback, certains députés menacent de réévaluer la coopération sécuritaire dans le golfe Persique, mettant en cause la stabilité régionale et les intérêts stratégiques occidentaux dans cette zone clé.
Retour du conflit iranien ?
Le souvenir des frappes de juin reste encore très présent. À cette période, les États-Unis et Israël avaient ciblé plusieurs sites nucléaires iraniens, notamment Natanz et Fordow, causant d’importants dégâts. En réaction, l’Iran avait juré de reconstruire et d’accélérer son programme nucléaire, en le présentant comme un symbole de résilience nationale face aux agressions extérieures.
Aujourd’hui, si les négociations en cours échouent, le risque de reprise des tensions militaires est réel. Comme le résume une analyste de l’IISS (International Institute for Strategic Studies) : « Nous sommes dans une phase de pré-conflit diplomatique. Le moindre incident pourrait faire dérailler l’ensemble du processus. » En effet, cela pourrait avoir un impact considérable sur les négociations entre l’Iran et les puissances européennes qui cherchent à, comme nous l’avons dit précédemment, ramener l’Iran dans le cadre de l’accord nucléaire de 2015, éviter l’activation du mécanisme de snapback, et empêcher toute escalade vers un conflit militaire.
La place de l’Europe dans tout ça ?
Pour l’Europe, le choix est délicat. Elle doit continuer à dialoguer avec l’Iran, malgré les tensions, au risque d’apparaître faible ou inefficace. À l’inverse, adopter une ligne plus ferme, comme activer le snapback, pourrait entraîner des conséquences incontrôlables. Le contexte complique encore les choses : Washington, focalisé sur sa politique intérieure sous Trump, reste en retrait, laissant l’UE en première ligne. « L’Union européenne est proche de l’impuissance stratégique », alerte un diplomate allemand. « Elle joue sa crédibilité en matière de sécurité internationale. Si elle échoue, l’Iran ne fera plus jamais confiance à sa médiation. »
Ces nouvelles négociations s’inscrivent dans un contexte tendu, où chaque geste diplomatique peut avoir un impact considérable. Dans un Moyen-Orient toujours instable, les menaces de sanctions, la surenchère nucléaire et la méfiance croissante compliquent toute tentative de désescalade. À Istanbul, les discussions pourraient influencer durablement l’équilibre de la sécurité nucléaire mondiale et régionale, sans garantie de succès.