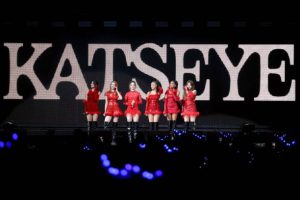Les langues autochtones ou langues ancestrales sont des dialectes parlés sur le continent Américain. Elle existe depuis l’installation des premiers individus jusqu’à l’arrivée des Européens, Asiatiques et Africains. Elles sont ainsi parlées par les Autochtones habitant du nord de l’Alaska, en passant par le Groenland jusqu’à la Terre du Feu (les territoires de l’archipel de l’extrême sud de l’Amérique du Sud).
Le continent Américain recueillerait plus de 800 langues autochtones très diverses. Elles sont regroupées en familles : par exemple en Amérique du Nord il y a les langues algiques ou auto-aztèques, en Amérique centrale, les langues mayas, ou oto-mangues sont plus nombreuses. Enfin, en Amérique du Sud principalement des langues isolées s’y trouvent.
De nombreuses langues autochtones sont aujourd’hui en danger, tandis que d’autres ont déjà disparu. Avec elles, ce sont des millénaires de savoirs, de traditions et d’identités culturelles qui s’éteignent à jamais. Selon les communautés autochtones, cette extinction linguistique est étroitement liée à la perte de leurs terres ancestrales. Cela les entraves pleinement dans leur expression culturelle et spirituelle.
Des efforts internationaux pour la conservation de ces langues ancestrales
Des organisations internationales telles que l’UNESCO parviennent à mettre en lumière la renaissance de ces langues qui tombent peu à peu dans l’oubli. Dans le cas de l’UNESCO, cette Organisation des Nations Unies “promeut la revitalisation de trois langues autochtones de l’Amazonie péruvienne”. Celle-ci met en place la décennie internationale des langues autochtones du monde (IDIL 2022-2032). Elle marque le début d’une renaissance officielle dans l’État du Pérou des langues autochtones Ikitu, Kukama Kukama et Taushiro.
Dans la phase initiale du projet, des études sociolinguistiques ont été menées au sein de chaque communauté, accompagnées d’ateliers participatifs. Ces derniers ont permis de créer une signalétique en langue maternelle. Mais aussi de produire des vidéos en stop-motion mettant en lumière non seulement la langue autochtone et les visions du monde propres aux communautés et leur relation à l’environnement. En parallèle, un livre consacré à la langue et à la culture Taushiro est en préparation. Ce projet s’appuie sur des données recueillies depuis 2016 par le ministère de la Culture, avec l’aide de chercheurs péruviens et étrangers. Notamment d’Amadeo García, l’unique locuteur encore fluent du Taushiro.
Le travail collaboratif entre l’UNESCO, le mouvement AMARUMAYU du Groupe AJE et le ministère de la Culture du Pérou se poursuivra en 2024 et 2025. L’objectif : renforcer les compétences locales pour permettre aux communautés de mener elles-mêmes des stratégies de transmission linguistique. Mais aussi de faire en sorte que ces langues autochtones continuent de vivre, d’évoluer et d’enrichir le patrimoine culturel péruvien.
Des aides venues tout droit du continent américain
Du côté du Canada, plusieurs initiatives sont lancées. D’abord, en 2019, une loi est promulguée reconnaissant l’importance des langues autochtones. Dès lors, les premières nations parlent des langues autochtones vivantes. Elles sont protégées dans des réserves naturelles, majoritairement dans le nord. Ainsi, plusieurs régions sont désormais des points clés de certaines cultures ancestrales. Par exemple, l’Inuit Nunangat devient l’endroit où se trouve la vaste majorité des locuteurs de l’inuktut sont réunis.
De plus les langues autochtones sont à présent parlées dans les grandes villes avec notamment Winnipeg. Elle compte la plus grande communauté de personnes parlant une langue autochtone. Edmonton comptait le plus grand nombre de métis parlant une langue autochtone. Ensuite, Ottawa-Gatineau comptait la plus grande population d’Inuit pouvant parler une langue autochtone. Sans oublier Montréal. En fin de compte, bien qu’en ces dernières décennies ces langues ancestrales marquaient des signes de grand déclin, voire d’extinction. Aujourd’hui, plusieurs signaux de revitalisation sont de plus en plus apparents et sont très encourageants.
Pour les États-Unis, un processus législatif est aussi engagé : Native American Languages Act (1990) : Cette loi fédérale soutient la préservation, le renforcement et la promotion des langues autochtones. De plus, de nombreuses initiatives locales contribuent à la conservation de ces précieuses langues : Des tribus comme les Navajos ou les Cherokees gèrent leurs propres programmes éducatifs bilingues, écoles d’immersion, dictionnaires et ressources numériques. Enfin, diverses technologies éducatives voient le jour comme des applis mobiles, des plateformes d’apprentissage en ligne et des partenariats avec des universités sont en plein essor.
Dans plusieurs pays d’Amérique latine, les gouvernements redoublent d’efforts pour faire face aux dangers qui pèsent sur les langues autochtones. Au Mexique, l’Institut national des langues indigènes (INALI) œuvre activement à la sauvegarde des 68 langues autochtones reconnues. Il développe des politiques linguistiques, élabore des alphabets standardisés et conçoit du matériel pédagogique. Ces langues bénéficient d’un statut officiel aux côtés de l’Espagnol, une reconnaissance constitutionnelle rare sur le continent.
Sur le terrain, des stations de radio communautaires diffusent aujourd’hui en nahuatl, zapotèque ou maya, renforçant la présence vivante de ces langues dans la sphère publique. Le Brésil, quant à lui, s’appuie sur la FUNAI et le Musée de l’Indien pour documenter les langues des peuples amazoniens. Des collaborations entre universités et communautés autochtones permettent de sauvegarder et revitaliser des langues en voie d’extinction, tandis que des écoles bilingues assurent un enseignement dans des langues telles que le tikuna ou le guarani.
Ces actions concertées traduisent une prise de conscience croissante de l’urgence à protéger ce patrimoine linguistique irremplaçable.